-
L'Arbre 2 - Chapitre 4- Le Promeneur
L’'Éden perdu
Chaque Homme a son jardin
Qu'un jour il oublia
Perdu dans le lointain
Brumeux de l'au-delà.
C'est un Éden magique
D'où remonte parfois
Le parfum nostalgique
Des bonheurs d'autrefois.
Il survit en nos cœurs
Où sont tous les chemins,
Qu'ils soient bordés de fleurs
Ou noyés de chagrins.
D'errances en dérives,
Voyageurs égarés,
Nous trouverons les rives
Du Jardin oublié…
A-M Lejeune
Le promeneur
Putain ! Où est-ce que je suis tombé ?
Ce petit matin du 7 août, un peu avant 4 heures, j'ai quitté la cité encore endormie. La journée s'y annonçait pareille à toutes les autres en ces lieux : grise, morne, malodorante. Une journée ordinaire dans une ville où les nuages perpétuels de pollution gomment les saisons. L'été ne se faisant sentir que par une lourdeur supplémentaire de l'air, le rendant par moment plus irrespirable encore.
Dans le vieux sac à dos datant de ma jeunesse folle, retrouvé avec le reste de mon attirail de randonneur au-dessus de l'armoire de notre chambre, j'ai calé de quoi me nourrir pour une longue équipée, mon couteau multi lames, une couverture de survie, une lampe de poche antédiluvienne, une gourde isotherme remplie d'eau fraîche…J'ai même retrouvé dans le placard aux « vieilles choses inutiles » comme dit ma femme moqueuse, le bâton de marche acheté autrefois dans une boutique de souvenirs, lors de lointaines vacances à la montagne, mes chaussures de rando, poussiéreuses mais qui me vont encore au poil et une tente monoplace en assez bon état pour ce que j'ai décidé d'entreprendre.
J'ai tout vérifié hier soir sous les yeux ébahis de ma moitié et de mes enfants de passage chez nous avec leurs rejetons.
- Tu n'as pas besoin de tout ça ! S'est esclaffée mon épouse. Tu ne pars pas huit jours quand même !
- On ne sait jamais, ça peut toujours servir au cas où ! Lui ai-je répondu le plus sérieusement du monde
- Au cas où quoi ?
- Où j'irais plus loin que prévu tiens ! Je ne compte pas rentrer de nuit tu sais !
- Et tu as une idée de l'endroit où tu vas ?
- Oui… Non…
- Oui ou non ?
- Oui… Enfin pas vraiment ! Je pars à l'aventure alors je préfère envisager une nuit dehors. Mais je serai rentré demain au plus tard. L'ai-je rassurée en lisant un brin d'inquiétude dans ses yeux habituellement si confiants.
- Tu as de ces idées toi ! C'est ta cinquantaine qui te taquine au moins ?
Je n'ai pas répondu et j'ai continué à préparer tout mon fourbi « hors d'âge » comme elle a dit en éclatant une nouvelle fois d'un rire moqueur.
« Un rire de crécelle ! » Ai-je pensé, agacé plus que de raison par ses remarques ironiques. Je m'en fous de ma cinquantaine ! Elle va bien ma cinquantaine ! Aussi bien qu'elle peut aller dans cette saloperie de ville bétonnée de bas en haut. Je respire aussi mal que la majorité de mes concitoyens, je porte résigné une légère bedaine parce que je manque d'exercice, embringué que je suis comme tout un chacun dans le cercle vicieux « métro-boulot-dodo » qui régit notre idéale société depuis des lustres. Un cercle suffocant que j'ai soudain eu envie de briser avant de m'étioler tout à fait et de perdre toute identité propre, totalement phagocyté par la mégapole tentaculaire où je bosse, je baise et je meurs à petit feu en oubliant qu'au-delà de son cœur de pierre et de ses frontières de brouillard fuligineux et puant, le soleil existe. Le vrai, le chaud, le merveilleux soleil, dans un ciel bleu comme la mer que je n'ai plus revue depuis mon adolescence, à part à la télé.
Ras le bol ! Voilà, c'est ça dont je crève ! D’un ras le bol soudain, brutal, étouffant, mortel ! Pire que l'air vicié que j'inhale du matin au soir.
Ça mûrissait en moi depuis quelque temps. Ma femme éberluée m'avait vu ressortir le lendemain de mon cinquantième anniversaire, le home-trainer que les enfants m'avaient offert pour mes 40 ans et qui n'avait vraiment servi qu'un an ou deux avant d'être mis au rebut. Pas le temps, plus l'envie…Et voilà que je m'y étais remis, comme ça, d'un coup. Je sentais avec délice mes mollets durcir, mon ventre mou retrouver quelque fermeté, mon souffle un peu court s'approfondir et un désir sournois d'aventure refaire surface dans mon esprit anesthésié par des années de mollesse et de résignation béate. L'idée avait germé, poussé et fleuri d'une grande randonnée en solitaire comme celles que j'affectionnais adolescent. Il n'y a pas de montagnes chez nous, ni l'océan, pas même une colline. Qu'importe ! Il y a l'horizon au-delà des murs de la cité…Un souvenir lointain…Une histoire extraordinaire entendue un jour… Et par dessus tout, le besoin, que dis-je, l'urgence de m'évader, de fuguer comme un môme en mal de liberté !
Et ça y est ! Harnaché de pied en cap de mon vieux barda dépoussiéré, chaussures bien lacées, je suis parti.
Mes sens émoussés par des années de mise en veilleuse, ont petit à petit retrouvé leur délicieuse acuité. Les deux ou trois premiers kilomètres ont été pénibles en dépit de mon entraînement soutenu. On ne rattrape pas en quelques mois toute une vie d'inactivité intensive. Foulée après foulée, mon souffle s'est accommodé à cet air si pur auquel je ne suis pas habitué. Un air qui devenait plus léger, plus délicatement parfumé au fur et à mesure que je m'éloignais des vapeurs létales de la Cité. Mes mollets noués de douleur se sont assouplis, mes pieds ont trouvé le bon rythme, ma voix éraillée s'est miraculeusement éclaircie. Machinalement j’ai commencé à fredonner tout bas, puis de plus en plus vigoureusement les airs entraînants de ma jeunesse, pour marquer le tempo de mes groles sur le long ruban de macadam. Alors, je me suis mis à avaler les kilomètres sans presque m'en rendre compte, heureux. Libre enfin ! De temps à autre, comme libéré lui aussi, mon rire éclatait tout seul, fort, haut, tonitruant, faisant s'envoler des nuées d'oiseaux des arbres et des fourrés bordant la route. Les automobilistes qui me croisaient, fou chantant à tue-tête et riant tout seul à gorge déployée, me montraient du doigt. Je n'en avais cure. Le monde soudain me paraissait plus beau. En me retournant au hasard d'une côte, je voyais encore les contours brumeux de la ville au loin. Elle me faisait penser à un immense vaisseau, gris, hostile, dangereux, venu d'une planète triste et inhospitalière, qui se serait posé là par inadvertance au beau milieu d'un paysage idyllique…
Je me surprenais à caresser l'idée que peut-être je n'y retournerais pas. Déjà, j'imaginais sans peine la tête de ma famille si policée à l'annonce de ma disparition corps et bien. D'autant que j'étais injoignable, ayant - sciemment ou pas - oublié mon portable sur le buffet du salon….
Mu par une envie pressante, après cette longue marche sans m'arrêter, ivre que j'étais de ma liberté toute neuve, je quittai la nationale pour m'enfoncer sur une petite route de traverse. Lorsque j'eus soulagé ce besoin naturel, je décidai d'emprunter un chemin vicinal afin d'y chercher un coin pour manger. Le soleil n'était plus loin de son zénith et la faim me tenaillait. La cadence de mes pas faiblissait. Les gargouillements intempestifs de mon estomac m'enjoignaient de faire halte pour déjeuner. Je portai un regard émerveillé autour de moi. De là où je me trouvais, on ne voyait plus la Cité. Le soleil baignait un paysage magnifique aussi loin que se posaient mes yeux. Hameaux nichés au cœur de mosaïques colorées de champs verts et blonds, avec leurs maisons basses aux toits de tuiles rouges regroupées autours de clochers droits comme des i dont les bourdons d'airain rythment les heures…Boqueteaux moutonnant, forêts plus denses aux mille dégradés de vert…Troupeaux paisibles de bovins paissant à l'ombre de pommiers croulant de fruits en attente d’être cueillis, dans des prés fleuris de coquelicots, de boutons d'or et de pissenlits…
Çà et là, le scintillement d'un ruisseau serpentin, d'un étang aux eaux dormantes ou d'une rivière sinueuse…
La nature victorieuse de ce début d'août chantait l'été à pleins poumons. Comme pour accueillir dignement le promeneur insolite et solitaire, une prairie parsemée de fleurs blanches, jaunes et rouges, m'offrit l'ombre d'un noyer imposant pour abriter mon pique-nique.
Quelques vaches impavides levèrent la tête à mon approche puis, jugeant sans doute ma présence sans danger, reprirent leurs sempiternelles mastications sans plus s'occuper de ce drôle d'humain assis sous son arbre, fort occupé lui-même à mâcher le pain ramolli farci de thon en boîte, de tomates sans saveur et d'œufs durs sortis tout droit de culs de poules de batterie. Un délice que je fis passer avec force rasades d'eau par chance encore fraîche. Deux pommes véreuses ramassées en cours de route et dûment débarrassées de leurs minuscules hôtes gigotant, complétèrent ce véritable festin de roi pour le marcheur affamé et fourbu que j'étais. Repu, je me suis allongé béatement sous l'ombrage feuillu du noyer et, la tête posée sur mon havresac, je m'y suis endormi aussitôt, tel un bébé sur le sein de sa mère. C'est le bourdonnement agaçant d'un insecte au niveau de mon nez qui m'a réveillé. Heureusement ! Sinon j'aurais pioncé jusqu'à pas d'heure. Depuis combien de temps n'avais-je pas aussi bien dormi, aussi totalement apaisé ? J'ai arrimé le sac à dos un peu plus léger sur mon dos reposé et je me suis remis en route.
En dehors de quelques ornières et de petits raidillons éprouvants pour mes mollets de néophyte, le chemin était facile et se faufilait entre les champs de blé, de maïs, de tournesol, de colza, de pommes de terre… reliant entre eux villages, hameaux, fermes isolées et lieux-dits aux appellations aussi évocatrices que charmantes. Les bas côtés avec leurs fossés herbus et leurs haies épineuses, s'agrémentaient des couleurs vives des pissenlits, des coquelicots, des marguerites et d'autres fleurs jaunes et bleues dont j'ignore les noms. In petto, je m'étonnais après toutes ces années de captivité intra muros, d'être encore capable de reconnaître tant d'espèces de fleurs, tant de variétés de culture. Une légère brise m'apportait par instant les parfums de foin coupé, de terre chaude et d'herbe fraîchement fauchée. Mes narines se gorgeaient avec délice de ces naturelles fragrances. Ne croisant pas âme qui vive hormis quelques paisibles ruminants, je me sentais comme un explorateur à la découverte d'une terre inconnue. J'étais seul au bout du monde, le cœur empli d'allégresse…J'en oubliais la rumeur de plus en plus ténue de la circulation sur la nationale, ailleurs, sur une autre planète, dans une autre galaxie…Sur celle-ci, les natifs circulaient cahin-caha à bord de poussifs tracteurs aux couleurs passées, ou juchés sur de vieux vélos brinquebalants. Nul fâcheux au volant de son bolide rutilant pour se gausser d'un promeneur isolé. Une espèce rarissime en cette époque dédiée à la vitesse. Au loin, sur la ligne d'horizon où tremblotait un translucide rideau de chaleur, une masse touffue, vert sombre au point d'en paraître noire, se découpait dans le ciel bleu, attirant irrésistiblement mon regard…
Était-ce là ?
 Tags : arbre, 2, chapitre 4, le promeneur
Tags : arbre, 2, chapitre 4, le promeneur
-
Commentaires
Ca me fait penser à une chanson de Michel Delpech où il parle d'un homme qui en a marre de sa vie routinière, ça dit : ce lundi-là, il s'en allait !
Il y a aussi celle de Sardou, mes chers parents, je pars.....
Il va arriver chez l'arbre.
bon jeudi.
 Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
 Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Mes écrits et mes cris du cœur







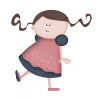






Bonjour Anne-Marie, tout comme Claudie, je crois bien qu'il arrivera chez l'Arbre ; je n'en serais pas la moindrement surprise ...
Bisous ♥